Notules dominicales de culture domestique n°232 - 6 novembre 2005
DIMANCHE.
Bercail (retour au). Au réveil,
le temps est toujours aussi exécrable. Nous ne retrouvons le soleil
qu'à partir du Puy et croûtons en terrasse près de
Saint-Etienne après nous être débarrassés d'une
bonne part de nos oripeaux mais pas d'un léger sentiment de culpabilité
à l'idée d'avoir laissé les aminches dans la brouillasse
cévenole. Sur une aire autoroutière, il nous semble bien
reconnaître la voiture des B., voisins de Saint-Laurent. Comment
faire lorsqu'un cas pareil se présente et qu'on n'a pas forcément
le temps ni l'envie d'explorer les toilettes ou la cafétéria
d'une station-services à la recherche de connaissances qui n'y
sont et qui n'en sont peut-être pas ? Ce n'est pas très difficile.
Vous prenez votre clé de contact et vous gravez un message bref
mais amical sur une portière du véhicule (évitez
les lettres curvilignes, difficiles à tracer) et comme vous êtes,
ne l'oubliez pas, en situation de doute, vous ne le signez pas. Une fois
de retour au pays, vous rencontrez vos éventuels voisins de stationnement.
S'ils vous racontent alors comment ils ont, à leur retour de vacances,
retrouvé leur voiture vandalisée par des sapajous, vos doutes
s'envoleront et vous aurez la certitude rassurante que vous êtes
un excellent physionomiste de parking.
Courrier. Je trouve une photo d'un
salon "Caract'Hair" de La Madeleine (Nord) à notre retour
de Loz'Hair. Merci à AZ.
Lecture. Plus amer que la mort
(Fred Kassak, 1957; rééd. in Romans I, Le Masque, coll.
Intégrales, présentation de Paul Gayot, postfaces de Fred
Kassak, 1998; 642 p., s.p.m.).
Atteint d'une maladie de cœur, Pierre s'accroche à ce qui lui reste
de vie pour mener à bien une dernière tâche : tuer
sa femme.
C'est le dossier de Temps noir évoqué la semaine
dernière qui m'a donné envie de remettre le nez dans Fred
Kassak. Le livre a un parfum désuet, celui du polar qualité
française des années 50, tendance Boileau-Narcejac : cadre
parisien, beaux quartiers, belles familles avec domesticité, querelles
d'héritage... Dans cette école, celle de la collection du
Masque, l'écriture n'importe guère : on écrit bien,
mais sans effet, sans fioriture. Ce qui est privilégié,
c'est l'intrigue, sa construction. Le roman policier est synonyme d'énigme,
de roman à suspense. L'auteur doit faire preuve de son habileté.
On parle, comme Paul Gayot dans sa présentation, de puzzle, de
devinette, de procédé. Et à ce jeu, il faut bien
dire que Kassak est un maître. Au début du livre, Pierre
s'apprête à tuer sa femme. Suit une série de retours
en arrière qui nous ramènent à la jeunesse du personnage.
Celui-ci fréquente alors plusieurs femmes, certaine par amour,
certaine par convenance, etc. L'identité de celle qu'il a épousée
(et qu'il va tuer) n'est pas révélée et il faut bien
sûr attendre le dernier chapitre pour connaître son identité.
Kassak est habile, le lecteur est pris au piège et ne lâche
pas le livre avant la fin.
Extrait du prologue, censé se dérouler en 1998. "Il
parcourut fébrilement du regard les rangées de livres et
se redressa, soulagé : le gros volume était bien là,
perdu au bout d'un rayon, en compagnie des ouvrages de Jean-Paul Sartre,
un philosophe encore célèbre trente ans plus tôt et
tombé dans l'oubli."
LUNDI.
Vie horticole. C'est la première
fois que je suis obligé de tondre la pelouse un 31 octobre. L'herbe
est grasse comme au printemps. Il n'y a décidément qu'en
Lozère où l'automne est à l'heure.
Courriel. Échange avec le rédacteur
en chef de La Liberté de l''Est en vue d'une pige littéraire.
Échange avec ST au sujet des tueurs de l'Ardèche.
TV. Desperate Housewives (série
américaine de Mark Cherry, 2004 avec Teri Hatcher, Marcia Cross,
Felicity Huffman, Eva Longoria, Nicolette Sheridan; saison 1, épisodes
16 & 17, diffusés sur Canal + le 28 octobre 2005).
MARDI.
TV. Ne quittez pas ! (Arthur
Joffé, France, 2004 avec Sergio Castellitto, Isabelle Gélinas,
Rachida Brakni).
Un homme est harcelé par son défunt père qui lui
téléphone de l'au-delà.
J'ai beaucoup aimé le portrait de cet homme, campé par un
Castellitto plus rêveur que jamais, vivant dans une totale nostalgie,
incapable de se séparer de quoi que ce soit, objets, personnes
ou sentiments. Quand, au téléphone, l'opératrice
lui dit la phrase titre, il répond : "Ne vous inquiétez
pas, mademoiselle, je ne quitte jamais rien ni personne." Malheureusement,
ce portrait n'occupe que le tout début du film qui se perd ensuite
dans une histoire interminable agrémentée de conversations
interstellaires qui ne valent pas un bon Don Camillo. Quant à la
fin qui mêle réconciliation familiale et souvenir de la Shoah,
elle tient tout simplement du grotesque.
Curiosité. On note une apparition éclair de Claude-Jean
Philippe en client d'un kiosque à journaux qui se fait voler son
téléphone de poche.
MERCREDI.
Emplettes. J'achète un roman
russe et le premier volume des aventures de Sherlock Holmes en édition
bilingue.
Vie festive. Alice fête pour la première fois
son anniversaire en compagnie de ses condisciples. Parmi eux, le jeune
B. J'inspecte, mine de rien, l'auto de ses parents. Soit ils n'étaient
pas sur l'autoroute A 6 dimanche dernier, soit ils ont un carrossier rapide
et efficace.
TV. Pigalle Saint-Germain-des-Prés
(André Berthomieu, France, 1950 avec Jacques Hélian,
Jeanne Moreau, Henri Génès; diffusé sur RTL 9 en
?).
L'orchestre de Jacques Hélian anime les soirées d'une boîte
de Pigalle tenue par des gangsters. Ne parvenant pas à se faire
payer correctement, les musiciens émigrent vers Saint-Germain-des-Prés
et jouent dans une cave qui vient d'ouvrir.
Il y eut au début des années cinquante quelques films où
les orchestres en vogue à l'époque tenaient la vedette.
Les films avec l'orchestre de Jacques Hélian (celui-ci, Musique
en tête, Tambour battant) ont disparu des mémoires mais
on a pu voir parfois à la télévision ceux dans lesquels
jouaient Ray Ventura et ses Collégiens (Nous irons à
Paris, Nous irons à Monte-Carlo). Ray Ventura est d'ailleurs
producteur de Pigalle Saint-Germain-des-Prés, un film dont les
intrigues policière et sentimentale (avec la débutante Jeanne
Moreau) n'ont guère d'intérêt. En revanche, c'est
un régal sur le plan musical. On y voit la naissance des boîtes
souterraines de Saint-Germain, les existentialistes gentiment caricaturés,
les danses endiablées, la jeunesse nouvelle en robe courte et chemise
à carreaux. On y voit et entend des chanteurs nommés Henri
Génès (disparu il y a quelques mois, je l'avais croisé
un jour à La Roche-Posay), Jean Marco (chanteur de charme gominé
qui devait se tuer dans un accident de voiture en 1953), Ginette Garcin
(!) et le chœur féminin des trois "Hélianes" aux
voix acidulées. La musique commence à swinguer, mais d'une
façon très sage : Jacques Hélian n'est pas un révolutionnaire,
il tente de suivre le mouvement mais va vite être dépassé
puisque son orchestre disparaîtra en 1956. Un bijou pour les amateurs
de kitsch ou, plus simplement, des musiques de l'époque.
Lecture. Au bois dormant (Boileau-Narcejac,
Denoël, 1956; rééd. in Quarante ans de suspense vol.
I, Robert Laffont, coll. Bouquins, édition établie par Francis
Lacassin, 1988; 1340 p., 120 F).
Le jeune Alain, en visitant les ruines du château de Muzillac, tombe
sur le testament de son arrière-grand-oncle, ancien occupant des
lieux.
C'est le texte de ce testament qui occupe presque l'intégralité
de ce court roman. Le comte de Muzillac y raconte son retour d'exil en
1815 et ses retrouvailles avec le château familial, près
de Rennes, passé aux mains de personnages bien étranges.
Si l'époque et les lieux évoquent dans un premier temps
Chateaubriand, ce sont les grands maîtres de la nouvelle fantastique
du XIX° siècle qui viennent ensuite à l'esprit. Boileau
et Narcejac réalisent en effet un véritable "à
la manière de", un collage dans lequel on peut s'amuser à
reconnaître des accents de Maupassant, Villiers de l'Isle-Adam,
voire Edgar Poe. Eux que l'on considère souvent comme des faiseurs
appliqués du roman policier bourgeois montrent leur habileté
à changer de registre : la tournure des phrases, le vocabulaire,
l'ambiance sont parfaitement calqués sur les récits de genre
de l'époque. Les phénomènes surnaturels qui surviennent
trouvent in fine une explication rationnelle mais, comme chez Théophile
Gautier, le doute subsiste grâce à la persistance de quelques
éléments troublants. Habile, très habile...
JEUDI.
Cinéma. Le Mystère
de la chambre jaune (Bruno Podalydès, France, 2003 avec Denis
Podalydès, Sabine Azéma, Pierre Arditi, Olivier Gourmet,
Claude Rich, Michael Lonsdale, Jean-Noël Brouté, Julos Beaucarne,
Isabelle Candelier; vu dans le cadre de la formation à Collège
au Cinéma).
Autant je peux lire et relire sans me lasser le livre de Gaston Leroux,
autant ce film m'ennuie davantage à chaque projection et ce n'est
pas le travail (?) inconsistant préparé (?) par le formateur
qui nous en parle ensuite qui va changer cet état de fait. L'après-midi,
au cours de laquelle je manque à plusieurs reprises de dévisser
de ma chaise, m'aura en tout cas appris, s'il en était encore besoin,
que je ne peux décidément survivre à la privation
de sieste.
TV. Desperate Housewives (série
américaine de Mark Cherry, 2004 avec Teri Hatcher, Marcia Cross,
Felicity Huffman, Eva Longoria, Nicolette Sheridan; saison 1, épisodes
18 & 19, diffusés sur Canal + le soir même).
L'ennui gagne, lentement mais sûrement.
VENDREDI.
Cinéma. L'Enfant (Jean-Pierre
et Luc Dardenne, France-Belgique, 2005 avec Jérémie Renier,
Déborah François, Jérémie Segard, Fabrizio
Rongione, Olivier Gourmet, Stéphane Bissot, Mireille Bailly, Anne
Gérard, Bernard Marbaix).
Bruno, un jeune délinquant, a besoin d'argent. Il apprend qu'un
couple pourrait acheter l'enfant que sa compagne vient de lui donner.
On est désormais habitué au cinéma des frères
Dardenne, à leur manière brutale de filmer, à leur
façon de projeter la réalité sociale sur l'écran
sans filtre adoucissant, à leurs acteurs fétiches (Renier,
Gourmet), à leur humanisme chrétien (l'enfant en Moïse,
Bruno en réincarnation de saint Christophe), à leur goût
pour le pardon des offenses. L'Enfant ne surprend donc pas, il
est dans la lignée des films précédents, de La
Promesse au Fils en passant par Rosetta. Cependant,
il captive moins, peut-être justement à cause de cette accoutumance,
et la Palme d'Or attribuée à Cannes semble un peu redondante
après celle de Rosetta. Malgré cette légère
déception, on reste dans un cinéma de haute tenue, fait
par des réalisateurs qui n'ont pas peur de se colleter avec le
réel. Ils montrent ici l'énergie déployée
par un jeune voyou, un gamin inconscient qui peu à peu, au fil
des épreuves, au bout d'un parcours épuisant, va trouver
l'apaisement. Un apaisement que l'on rencontre aussi dans la mise en scène
moins heurtée que d'habitude et qui rapproche les Dardenne de Robert
Bresson.
Courriel. Une demande d'abonnement
aux notules.
SAMEDI.
Football. S.A.Spinalien - Wasquehal
: 0 - 4.
Ouille.
Courrier. Arrivée d'un livre
consacré aux tueurs de l'Ardèche déniché,
magie de l'Internet, dans une librairie de l'État de New York.
Courriel. Les notules montent à
l'assaut des Hautes-Alpes.
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°233 - 13 novembre 2005
DIMANCHE.
Vie hospitalière. Nous rendons
visite à la mère de Caroline dans une clinique de Nancy.
Nous sommes en traumatologie mais les filles ne sont pas traumatisées
pour autant et apprécient les courses en fauteuil roulant.
Hulot. Le dimanche, c'est le jour
du bricolage, donc une journée à potentiel catastrophique
élevé. Le matin, je m'en étais plutôt bien
tiré avec la pose d'un nouveau plafonnier dans la chambre des filles.
Mis en confiance, j'entreprends à notre retour de Nancy de remettre
en état un lustre défectueux dans l'autre chambre, un truc
dont on ne se sert jamais et qui aurait tout aussi bien pu continuer à
rester endormi jusqu'à la nuit des temps. Rapidement, ce n'est
pas une surprise, l'initiative se transforme en catastrophe industrielle.
En cinq minutes, je fais exploser un bon nombre de fusibles et prive la
maison de chauffage et d'une bonne partie de ses appareils ménagers.
Je dois dire à ma décharge (électrique), que dans
cette cabane, l'installation (électrique) semble avoir été
faite avant l'invention de l'électricité. La chasse aux
fusibles, qui se déroule comme il se doit un dimanche et à
la nuit tombée, n'est pas un sport aisé mais je trouve chez
O. de quoi remettre en état la majeure partie de notre potentiel
électrique. Bien sûr, il n'y a plus de courant dans notre
chambre mais ça ne gêne pas pour dormir. Caroline refuse
absolument que je tente une réparation immédiate. Pourtant,
je me sentais en forme mais il est vrai que je commençais à
devenir grossier.
Courriel. Une demande d'abonnement
aux notules et un nouvel aptonyme, bijoutier parisien nommé Caillou.
LUNDI.
TV. Trois petites filles (Jean-Loup
Hubert, France, 2004 avec Gérard Jugnot, Adriana Karembeu, Morgane
Cabot; diffusé sur Canal + en octobre 2005).
La fugue de trois adolescentes en Corse, à la recherche de la maison
de Johnny Depp et Vanessa Paradis.
Voilà quelque chose qui pourrait aisément concourir dans
la catégorie du film le plus niais de l'année 2004. Ce n'est
pas grave, on en a vu et on en verra d'autres, mais c'est tout de même
un peu étonnant de la part de Jean-Loup Hubert, qu'on a connu nettement
plus inspiré. L'expérience lui aura peut-être appris
qu'il est risqué d'engager des débutantes sans leur donner
de cours de diction : non seulement le film est vide, mais on n'en comprend
qu'une phrase sur deux. Quant à Adriana Karembeu, dont c'est aussi
le premier rôle, souhaitons que sa carrière ne soit pas à
l'image de ses jambes, qu'on dit interminables. Sur le thème des
aventures adolescentes, mieux vaut cent fois voir ou revoir La Vie
ne me fait pas peur de Noémie Lvovsky.
Courrier. J'envoie à JCB un
article sur Émile Friant dont il saura faire bon usage. N.B. Le
peintre Émile Friant n'est pas l'inventeur du Jeu d'Émile
Friant qui précéda sur France Inter le Jeu d'Émile
Heurot. Qui rime avec Vermot.
MERCREDI.
Presse. Je rencontre GN, rédacteur
en chef de La Liberté de l'Est en vue d'une collaboration à
sa page littéraire et de la publication d'un portrait du notulographe.
Trois quarts d'heure d'un entretien agréable mais dont je sors
totalement vidé. Ecrire sur soi, soit, mais parler de soi, c'est
autre chose.
TV. En route pour la gloire
(Bound For Glory, Hal Ashby, E.-U., 1976 avec David Carradine,
Ronny Cox, Melinda Dillon, Gail Strickland; diffusé sur ARTE en
?).
En 1936, le jeune Wody Guthrie quitte le Texas, où les effets de
la Grande Dépression se font encore sentir, pour la Californie.
Lorsqu'il y arrive, après un voyage mouvementé à
pied ou en passager clandestin des trains de marchandises, il découvre
que ce n'est pas la Terre Promise. Les migrants sont parqués dans
des camps d'où ils parviennent parfois à s'extraire pour
travailler dans les plantations pour un salaire de misère. Woody
se sert de sa seul arme, sa guitare, pour adoucir l'existence de ses semblables.
Il est remarqué par le directeur d'une station de radio qui lui
confie un programme. Ses chansons, qui contiennent des appels clairs à
la rébellion et à la syndicalisation, font rapidement fuir
les annonceurs.
On ne traite ici que de six années de la vie de Woody Guthrie,
en gros de son séjour en Californie jusqu'à son départ
pour New York. On le voit donc en vagabond, en "hobo", mais
pas en pleine gloire ni à la fin de sa vie, à l'hôpital
où il reçut la visite d'un adolescent ému et admiratif
nommé Bob Dylan, un Dylan dont une des premières chansons
allait s'intituler "Song to Woody". Le film n'est pas formidable
et David Carradine n'est pas un interprète inoubliable des chansons
de Guthrie mais c'est un film majeur dans mon histoire personnelle. Je
l'ai vu à sa sortie, alors que j'étais encore au lycée,
et ce fut l'occasion d'une double prise de conscience. Une prise de conscience
musicale d'abord qui eut pour conséquences quasi immédiates
l'achat d'un harmonica et d'un banjo cinq cordes, la substitution de la
guitare folk à la guitare classique et l'apprentissage des chansons
de Guthrie. Il n'y eut pas un concert de Garlamb'Hic sans l'une d'elles
au répertoire, "Do Re Mi" ou "Dusty Road".
Plus tard devaient venir Dylan, puis Springsteen, ses héritiers
directs, mais tout a commencé avec Woody Guthrie. Une prise de
conscience sociale ensuite, ou plutôt en même temps, avec,
à la même époque, la découverte du Sacco
et Vanzetti de Giuliano Montaldo et la lecture de Steinbeck, puis
la version filmée par John Ford des Raisins de la colère,
des histoires de révolte, de solidarité, de cœur qui bouleversaient
mon esprit adolescent. "C'est ce qui m'a fait", écrivait
Sartre dans Les Mots.
JEUDI.
TV. Desperate Housewives (série
américaine de Mark Cherry, 2004 avec Teri Hatcher, Marcia Cross,
Felicity Huffman, Eva Longoria, Nicolette Sheridan; saison 1, épisodes
20 & 21, diffusés sur Canal + le soir même).
VENDREDI.
Vie patriotique. J'accompagne Lucie,
réquisitionnée pour aller déposer un bouquet et pousser
une Marseillaise - dont les mâles accents ont résonné
toute la semaine dans notre foyer, mais pas toujours avec les paroles
orthodoxes - au monument aux morts de Saint-Laurent. On a fait appel à
une connaisseuse. Je n'ai pas pour habitude de vanter l'excellence de
ma progéniture - d'autant qu'elle va de soi dans le cas de l'aînée
puisque nous avons légué en substance à Lucie nos
gènes - mais pour ce qui est des monuments aux morts elle bénéficie
d'une expérience certaine.
Vie lumineuse. Restauration du parc
électrique domestique dans son intégralité, lustre
réfractaire compris. Le bricolage, c'est comme les mots croisés
: vous laissez quelque temps le problème en jachère et la
solution apparaît comme ça, sans effort, quand vous le reprenez.
TV. Pédale dure (Gabriel
Aghion, France, 2004 avec Dany Boon, Gérard Darmon, Michèle
Laroque, Jacques Dutronc; diffusé sur Canal + en octobre 2005).
Un couple d'homosexuels attend un enfant porté par une de leurs
amies.
Gabriel Aghion s'est fait une spécialité : celle de traiter
un sujet de société (l'amour intergénérationnel
dans Belle Maman, l'homosexualité dans Pédale
douce, l'homosexualité et la paternité ici) d'une façon
si caricaturale, superficielle et grossière qu'on peut le considérer
comme le faiseur des films les plus détestables de ces dernières
années. Il parvient à rendre mauvais comme des cochons des
acteurs sympathiques partout ailleurs (Darmon) et à qui un film
avec Aghion semble d'ailleurs suffire (où sont passés les
Timsit, Berry, Gamblin de Pédale douce ?). Scénario
vide, mise en scène au ras du gazon, il n'y a rien, rien, pas une
idée là-dedans. On est loin de La cage aux folles...
SAMEDI.
Téléphone. Conversation
avec CD, notulien ardéchois, assortie d'une promesse de rencontre
lors d'un futur séjour en Lozère.
Vie familiale. Nous profitons de l'absence
de couvre-feu pour aller croûter chez mes parents et faire connaissance
avec le jeune Rémi, neveu.
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°234 - 20 novembre 2005
DIMANCHE.
Itinéraire patriotique départemental.
Découverte du monument aux morts de Belval, un village
situé près de Senones, cité vosgienne bien connue
des amateurs de palindromes (mais pas la seule puisque le département
compte aussi un Laval). Lucie prend des photos pour la presse locale.
TV. Le Château de l'Araignée
(Kumonosu jô, Akira Kurosawa, Japon, 1957 avec Toshirô
Mifune, Isuzu Yamada, Minoru Chiaki; diffusé sur ARTE en ?).
Revenu vainqueur d'une expédition, Washizu rencontre dans une forêt
une sorcière qui lui prédit qu'il deviendra le seigneur
du Château de l'Araignée et que le fils d'un de ses frères
d'armes lui succédera. Poussé par sa femme, Washizu assassine
l'actuel seigneur du château.
Où l'on découvre, s'il en était besoin, la parfaite
universalité des thèmes shakespeariens puisque cette histoire
n'est autre que l'adaptation de Macbeth, transposée dans le monde
des samouraïs. Kurosawa reprend point par point l'intrigue du drame
et la plie à ses propres conventions, à sa manière
de filmer violente et théâtrale, servie par un Toshirô
Mifune grandiloquent. Les scènes de bataille préfigurent
celles de Ran, reprise d'un autre motif shakespearien, celui du Roi Lear.
On ne peut pas dire que ce soit confortable à regarder mais la
séquence finale, la mort de Washizu transformé en pelote
d'épingles par les flèches de ses sujets, est tout de même
un sacré morceau.
Lecture. Penser la mélancolie.
Une lecture de Georges Perec (Maurice Corcos, Albin Michel; 280 p.,
17,50 €).
Critique à rédiger pour La Liberté de l'Est.
LUNDI.
Courrier. Une carte postale d'Édimbourg.
TV. Le grand rôle (Steve
Suissa, France, 2004 avec Stéphane Freiss, Bérénice
Bejo, Peter Coyote, François Berléand; diffusé sur
Canal + en octobre 2005).
Maurice Kurtz, comédien obscur, fait croire à sa femme,
atteinte d'un cancer fatal, qu'il a décroché le premier
rôle d'une superproduction.
On est dans la semaine Shakespeare puisque la superproduction en question
n'est autre qu'une adaptation, en yiddish s'il vous plaît, du Marchand
de Venise pour laquelle Kurtz prétend avoir obtenu le rôle
de Shylock. Le mensonge qu'il échafaude avec l'aide ses amis a
le même but que celui qui apparaissait dans Goodbye Lenin
: atténuer les souffrances d'un être cher. La ficelle est
un peu grosse mais on suit cette histoire avec plaisir. La bande de copains
qui entoure Kurtz est jouée par un groupe d'acteurs sympathiques
(Lionel Abelanski, Laurent Bateau, Olivier Sitruk) qui donnent l'image
d'une amitié simple et sincère. Un film gentil, qui évite
adroitement le piège de la mièvrerie.
MARDI.
Courriel. Un message de GN, qui s'emploie
à rédiger un portrait du notulographe : "Besoin pour
mon article de savoir combien de fois vous avez mangé du lapin
au cours de l'année 1997. Merci." Heureusement, c'est le genre
de question à laquelle je peux répondre presque instantanément.
N'empêche : l'article promet d'être pointu.
TV. Un jour... le Nil (al-Nass
wal Nil, Youssef Chahine, Égypte/URSS, 1968 avec Salah Zulfikar,
Igor Vladimorov, Imrad Hamdi; diffusé sur ARTE en octobre 1999).
1964 : la construction du barrage d'Assouan touche à sa fin.
C'est le moment où les ingénieurs soviétiques, qui
ont apporté leur collaboration à l'édification du
barrage, s'en vont. Chahine présente plusieurs histoires personnelles
qui se mêlent, celle d'un vieux paysan qui voit le cours du fleuve
s'éloigner de son village, celle d'un jeune ouvrier local qui essaie
de retenir son ami Nikolaï, celle d'un écrivain engagé
comme manœuvre, celle d'un couple russe au bord de la rupture... Il y
en a d'autres, il y en a tant qu'on finit par se perdre dans la cohue
pour garder l'image d'une oeuvre qui est en fait à l'image du barrage
: fruit d'une collaboration internationale inattendue, démesurée,
majestueuse. Pour corser la macédoine, Chahine a choisi de tourner
à l'américaine, format scope, musique symphonique, destins
mélodramatiques... Il ne manque qu'Elizabeth Taylor en princesse
des sables ou Gregory Peck en ingénieur débarqué
de Leningrad. Le film sera refusé par les autorités, tant
soviétiques qu'égyptiennes, qui l'avaient commandé,
et ne verra le jour que grâce au travail de la Cinémathèque
française. Chahine, lui, dut recommencer et faire un film plus
en accord avec ce qui lui était demandé, Les Gens du
Nil, qu'il renia par la suite.
MERCREDI.
Emplettes. J'achète des billets
de train, un polar mathématique, un livre sur Kafka et complète
ma collection de Jules Verne.
Écriture. J'ai rédigé
hier soir ma critique du livre sur Perec pour le quotidien local. J'ai
rédigé ça comme une notule, au fil du clavier, assez
facilement. Bilan statistique : plus de 3500 signes. J'ai droit, contrainte
journalistique, à 2500. Je passe donc une partie de la journée
à tailler dans le vif, dégraisser, ébarber, élaguer,
émonder mon texte, peser chaque mot et chaque virgule pour arriver
à la taille souhaitée. Exercice nouveau pour moi, donc pas
facile, mais intéressant dans la mesure où il oblige à
aller à l'os, sans fioritures, tout en essayant de garder le ton
qu'on souhaite donner à la chose. Quatre heures de boulot pour
quatre paragraphes : je ne ferais pas long feu dans une rédaction.
TV. Vipère au poing
(Philippe de Broca, France/G.-B., 2004 avec Catherine Frot, Jacques Villeret,
Jules Sitruk; diffusé sur Canal + en novembre 2005).
Élevés par leur grand-mère, Jean, dit "Brasse-Bouillon",
et son frère attendent avec impatience le retour de leurs parents.
Lorsque ceux-ci débarquent en provenance de Saigon, les enfants
doivent vite déchanter : leur mère, qu'ils surnomment rapidement
Folcoche, est une marâtre cruelle et autoritaire.
Curieux parcours que celui de Philippe de Broca qui commence une carrière
dans les années soixante comme compagnon de route de la Nouvelle
Vague pour terminer par ce film, adaptation littéraire d'un académisme
total. Ma lecture de Bazin est très lointaine mais il me semble
que dans le livre, la haine des enfants pour Folcoche était beaucoup
plus palpable et féroce qu'ici où Catherine Frot ne parvient
pas à rendre le personnage aussi mauvais qu'il le devrait. Le jeune
de Broca aurait sans doute voué ce film aux gémonies. Mais
le jeune Truffaut n'aurait-il pas fait de même avec Le dernier métro
?
JEUDI.
Vie des hommes illustres. Le jour
de gloire est arrivé : La Liberté de l'Est consacre une
page entière aux notules et à mes divers chantiers, avec
annonce et photo en une, reproduite ci-dessous. Je chausse des lunettes
noires et promeus R. au rang de chauffeur garde du corps. Comme la journée
a décidé d'être belle, je m'offre en sus un petit
tiercé dans le désordre (7-6-5).
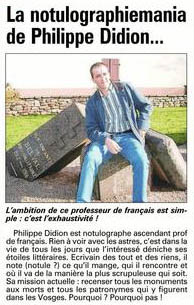
Cliquer
sur l'image pour voir la une
Citation.
Dénichée dans Le Monde, sous la plume de Francis Marmande
: "Les vies des professeurs sont rarement intéressantes"
(Gilles Deleuze).
TV. Desperate Housewives (série
américaine de Mark Cherry, 2004 avec Teri Hatcher, Marcia Cross,
Felicity Huffman, Eva Longoria, Nicolette Sheridan; saison 1, épisodes
22 & 23, diffusés sur Canal + le soir même).
Comme attendu, les choses s'accélèrent pour ces deux derniers
épisodes. On connaît enfin les raisons du suicide de Mary
Alice qui faisait l'ouverture de la série et la saison se termine
sur une très belle scène qui montre Bree, une des héroïnes,
confrontée à la solitude après la mort de son mari.
De quoi oublier les longueurs qui ont précédé et
être volontaire pour suivre une deuxième saison.
VENDREDI.
Écriture. Je commence à
travailler sur le Bulletin Perec, que je dois rendre la semaine prochaine.
Après ça, il sera temps de me mettre à ma deuxième
chronique pour Histoires littéraires. En fait, je m'aperçois
qu'entre La Liberté de l'Est, Histoires littéraires
et Perec, sans parler des notules, je n'ai pas dételé depuis
septembre. Finalement, les vies des professeurs peuvent être intéressantes
quand ils font autre chose que professer.
SAMEDI.
Lecture. Histoires littéraires
n° 15 (revue trimestrielle consacrée à la littérature
française des XIX° et XX° siècles, juillet-août-septembre
2003, Histoires littéraires et Du Lérot éditeurs;
272 p., 20 €).
On ouvre avec un hommage à Noël Arnaud, surréaliste,
pataphysicien et oulipien mort en 2003, dont on donne ici quelques lettres
inédites. L'une d'elles, destinée à Claude Rameil,
déborde de tendresse envers une ancienne figure de Saint-Germain-des-Prés
: "Hier soir, je prends l'émission de Rutman. Aux premières
images : "Zut ! me dis-je, je me suis gourré (sic) de chaîne
: c'est un show Juliette Gréco !" Dans la seconde partie,
elle se décide à s'effacer un peu, mais elle revient en
force à la fin de l'émission et l'émission se termine
sur elle faisant un geste d'une stupide théâtralité.
Quelle idée d'aller chercher cette ringarde, qui chante de plus
en plus mal et qui n'a strictement rien à dire, même si elle
le dit en prenant des mines de vieille tragédienne de sous-préfecture
!"
Par ailleurs, on s'intéresse aux origines du roman-feuilleton,
à Mallarmé, à Michaux et aux tournois de poétesses
organisés par les premiers journaux féminins dans les années
1910. Au rayon découvertes, Jean-Jacques Lefrère ressuscite
Ephraïm Mikhaël, poète toulousain mort en 1890 à
l'âge de vingt-trois ans et à l'aube d'une carrière
prometteuse. Une des lettres inédites exhumées par Lefrère
mentionne un certain général Pittié, joli contraptonyme.
Restons dans la correspondance avec la rubrique qui, traditionnellement,
clôt chaque numéro de la revue, rubrique intitulée
"Courrier des lecteurs contents et mécontents". Un libraire
parisien se fend d'une succincte épistole ainsi libellée
: "Je vous prie de signaler dans votre rubrique des lecteurs contents
et mécontents que je suis content."
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°235 - 27 novembre 2005
DIMANCHE.
Lecture. Les Esperados. Histoire
vraie (Yannick Blanc, Robert Laffont, 1984; 230 p., 69 F).
Il y eut, à l'origine, un numéro du Vif du sujet,
l'émission de France Culture consacrée aux faits divers,
diffusé en juin dernier (et encore audible
ici).
Il y était question des "tueurs fous de l'Ardèche",
une affaire dont j'avais gardé un lointain souvenir (l'histoire
date tout de même de 1977) et dont le récit réveilla
mon attention lorsque Villefort, une bourgade de Lozère où
il m'arrive de séjourner, fut mentionnée comme le point
de départ de la cavale des tueurs en question après le braquage
du Crédit Agricole local. Le mois dernier, je rencontrai JS à
Villefort, et je lui parlai de l'affaire qu'elle connaissait bien et pour
cause : elle était caissière au Crédit Agricole au
moment des faits et s'était trouvée au bout du canon des
tueurs. Elle me raconta sa version des faits et m'apprit qu'elle avait
été un jour interviewée par un journaliste qui devait
écrire un livre sur le sujet, un livre qui avait vu le jour mais
qu'elle n'avait jamais réussi à dénicher.
Ce livre, c'est Les Esperados, que j'ai pu retrouver, traquer et
commander via internet. Il raconte la vie de Pierre Conty, originaire
de Grenoble, rebelle, insoumis, idéaliste, adepte du retour à
la terre dans le sillage de la chanson de Ferrat La Montagne. Après
quelques essais infructueux, Conty s'installe avec sa compagne dans un
hameau abandonné de l'Ardèche, Rochebesse. Des amis les
rejoignent et peu à peu voit le jour la première communauté
du département, dès avant Mai 68. Yannick Blanc raconte
minutieusement l'installation, les premiers pas, les difficultés
extérieures d'abord (le climat, la pauvreté de la terre,
les relations de plus en plus tendues avec les autochtones qui voient
d'un mauvais oeil ces hippies s'approprier des terres et des bâtisses
qu'ils avaient pourtant abandonnées) puis internes : la communauté
s'étoffe, Conty doit s'imposer pour montrer qu'il est le chef,
des parasites s'installent, les luttes pour le pouvoir et les histoires
de fesses lézardent le rêve. La vente des fromages de chèvre
ne suffisant pas à faire vivre tout ce monde, les moyens illégaux
sont mis en oeuvre : on pille les chantiers pour refaire les maisons,
on détourne les livraisons des magasins, on vole des chèques,
des armes aussi parce qu'on croit la révolution proche. Jusqu'au
jour d'août 1977 où Conty et deux de ses amis descendent
à Villefort pour se faire le Crédit Agricole. C'est JS qui
raconte les visages masqués, les 78000 francs du coffre, les employées
bouclées dans les toilettes avec la trouille de prendre une rafale
de pistolet-mitrailleur à travers la porte, les gendarmes finauds
qui, prévenus que quelque chose de bizarre est en train de se passer,
ne trouvent pas mieux que de téléphoner... à la banque
au risque de provoquer une tuerie. Le trio s'enfuit et se fait repérer
par une voiture de gendarmerie pour... excès de vitesse. Conty
tue un pandore, un autre parvient à s'enfuir. Il faut changer de
voiture, la leur va être signalée. Pour cela, Conty abat
deux pauvres types qui ont le malheur de passer par là au mauvais
moment, et retourne se planquer à Rochebesse. Un de ses amis se
rendra de lui-même à la police, l'autre sera repris en Hollande.
Conty parviendra à s'enfuir de Rochebesse et ne sera plus jamais
revu.
Ici s'arrête le récit de Yannick Blanc, laissant quelque
peu le lecteur sur sa faim : on aurait aimé vivre ensuite le procès
des deux complices, les assises à Privas avec Badinter comme défenseur,
voir ce qu'est devenu Rochebesse après Conty, et filer aux trousses
de celui-ci qui a été signalé un peu partout en Ardèche
mais aussi, depuis, en Italie, en Algérie, au Nicaragua... Le livre
possède les défauts du genre : à partir de témoignages
recueillis, l'auteur reconstitue des dialogues, brode, prête tel
ou tel sentiment aux uns et aux autres, laisse des trous béants
dans une chronologie qu'on aurait aimé plus minutieuse. Mais ce
ne sont ici que des détails : la personnalité de Conty,
le cadre, le contexte socio-historique sont tellement passionnants qu'on
les oublie rapidement. On se demande tout de même pourquoi aucun
scénariste ne s'est emparé de cette histoire...
Itinéraire patriotique départemental.
Le monument aux morts de Bertrimoutier vaut le déplacement puisqu'il
regroupe les victimes de sept villages, ce qui m'épargne les futurs
voyages prévus à, dans l'ordre, Combrimont, Frepelle, Lesseux,
Neuviller-sur-Fave, Pair-et-Grandrupt et Raves.
Football. Le SAS est sorti sans gloire
de la Coupe de France par l'équipe de Rethel. Cela ne me réjouit
pas outre-mesure mais je me console en tirant de mes tiroirs cette histoire
brève que je ne pensais pas avoir l'occasion de placer un jour
: "J'ai rencontré André vers Suresnes (Hauts-de-Seine).
Il jouait du piano à Rethel (Ardennes)."
TV. Aaltra (Benoît Delépine
& Gustave Kervern, France/Belgique, 2004 avec Benoît Delépine,
Gustave Kervern, Benoît Poelvoorde; diffusé sur Canal + en
novembre 2005).
Dans une zone désertique du nord de la France, deux voisins entretiennent
les relations les plus inamicales qui soient. Au cours d'une dispute,
ils finissent tous deux les jambes broyées par une machine agricole
défectueuse. A peine sortis de l'hôpital, ils partent pour
la Finlande où ils ont l'intention de se faire dédommager
par la société Aaltra, le constructeur de la machine.
On n'avait pas encore tenté au cinéma le road movie
en fauteuil roulant. Voilà qui est fait avec ce film qui revendique
un double héritage : celui d'une école belge qui, dans la
mouvance de C'est arrivé près de chez vous, pratique un
humour absurde et dévastateur et celui du réalisateur finlandais
Aki Kaurismäki. Ce dernier apparaît d'ailleurs à la
fin du voyage, dont la destination, la Finlande, n'est bien sûr
pas innocente. Aaltra, par le mutisme de ses personnages, son image en
noir et blanc, son manque total de cohérence et de logique évoque
immanquablement Tiens ton foulard, Tatiana du réalisateur
finlandais dont il copie même certaines scènes (celle du
bar avec un irrésistible Bouli Lanners en chanteur finnois). Ce
n'est pas une oeuvre à mettre devant toutes les prunelles mais
si on aime le genre, c'est un régal. Le générique
est à lui seul une merveille, non par son graphisme mais par son
contenu : 93 acteurs et figurants crédités, à croire
que la moitié de la Belgique a participé au film, dans des
rôles soigneusement répertoriés : Vincent Patar est
"le vendeur de tickets obstiné", Oviedo est "la
voix espagnole", Robin Weerts est "Jérémy, le
fils du fan de moto-cross", Gaspard Tavier est "l'enfant mangeur
de frites", Peter Vanrutten est "le second piéton entreprenant",
Abdelaziz Bachaou est "l'éplucheur de pommes de terre"
et Harro Geerts "le conducteur du camion fantôme" (qu'on
ne voit même pas !). De plus, atout non négligeable, Aaltra
est assuré d'occuper la première place des dictionnaires
de films pendant un bon moment.
Courriel. Jean-Jacques Lefrère
m'annonce qu'après avoir considéré mon premier envoi,
le comité de rédaction de la revue Histoires littéraires
espère me voir assurer ma chronique dans chaque livraison. Je m'endors
heureux.
LUNDI.
Courrier. J'envoie Les Esperados
à JS en Lozère et ventile quelques copies de l'article Liberté
de l'Est.
TV 1. Tous en scène
(The Band Wagon, Vincente Minnelli, E.-U., 1953 avec Fred Astaire,
Cyd Charisse, Oscar Levant, Nanette Fabray; diffusé sur TCM en
?).
Un danseur à la carrière déclinante débarque
à New York et reprend le chemin du théâtre pour une
version moderne de Faust.
Le film a été enregistré avant que je ne découvre
l'existence et les vertus de la touche multilingue de la télécommande.
Pas de chance, il s'agissait d'une diffusion en version française,
ce qui est moyennement gênant pour les dialogues mais devient carrément
rédhibitoire lorsqu'on va, comme ici, jusqu'à doubler les
chansons d'une comédie musicale. C'est impossible à suivre,
tout sonne faux, l'orchestre s'entend à peine, c'est un massacre.
Dommage, l'histoire de ce danseur sur le retour, interprété
par un Fred Astaire qui connaissait bien le problème à l'époque,
valait mieux même si sur le plan visuel Tous en scène
semble tout de même moins abouti que Chantons sous la pluie,
tourné l'année précédente pour le même
producteur, Arthur Freed. Désolé pour mon cher Minnelli.
TV 2. Le dernier tournant (Pierre
Chenal, France, 1939 avec Fernand Gravey, Michel Simon, Corinne Luchaire,
Charels Blavette, Robert Le Vigan, Marcel Vallée; diffusé
sur France 2 en ?).
Un vagabond est embauché par le patron d'un poste d'essence. La
femme de celui-ci séduit celui-là et le couple cherche à
se débarrasser du mari.
C'est la toute première adaptation, sept ans avant celle de Tay
Garnett, du livre de James Cain, Le facteur sonne toujours deux fois,
prototype du roman noir poisseux. Pierre Chenal a déplacé
l'intrigue dans la région de Marseille et a conservé les
protagonistes et la trame du roman. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, juste
une curiosité parce que, malheureusement, Fernand Gravey ne convient
pas au rôle de Franck le vagabond. En revanche, Michel Simon est
égal à lui-même, il faut dire qu'après La
Chienne, il a l'expérience de ce genre de rôle. C'est
en tout cas l'occasion de découvrir, dans le rôle de la femme
fatale, Corinne Luchaire dont la beauté ne résista pas,
si l'on peut dire, à quelques choix malheureux pendant l'Occupation.
MERCREDI.
Courrier. Je reçois deux numéros
du Nouvel Attila qui ressemble, déception, plus à
une feuille qu'à une revue.
Presse. C'est une photo en bas de
page du Monde. Une route, des prés, des vaches et dans le fond,
un village du genre "force tranquille" époque mitterrandienne.
La légende : "Aisne joy*". Il faut aller voir ce à
quoi renvoie l'astérisque ("Profite de la vie dans l'Aisne")
pour comprendre qu'il s'agit d'une subtile variation homophonique bilingue
sur le mot anglais "Enjoy". C'est apparemment fait pour attirer
le touriste britannique dans le département puisqu'on peut lire
également dans un encadré "l'Aisne it's open".
On a plaisir à constater que certains conseils généraux
rémunèrent, avec l'argent de leurs administrés, des
cabinets de communication à l'imagination aussi fertile.
Courriel. Une demande d'abonnement
aux notules.
JEUDI.
Courriel. Une demande d'abonnement
aux notules.
TV. 24 heures chrono (24, série
américaine de Robert Cochran & Joel Surnow avec Kiefer Sutherland,
Kim Raver, William Devane, Mary Lynn Rajskub; saison 4, épisodes
1 & 2 diffusés sur Canal + le soir même).
Jack Bauer a été renvoyé de la cellule anti-terroriste.
Il apparaît ici en costume-cravate comme conseiller du ministre
de la Défense, roucoulant avec la fille de celui-ci. Bien sûr,
on n'y croit pas une seconde. Heureusement, le ministre et sa fille sont
vite kidnappés et Bauer jette son déguisement aux orties
pour endosser la tenue du baroudeur qu'on lui connaît. La série
est un peu victime de son succès : le coup de maître que
constituait la première saison a fait long feu, les suites ne l'ont
jamais égalée. Un autre effet du succès, plus pervers
celui-là, met en cause le principe même de la série,
censée se dérouler en temps réel, soit vingt-quatre
épisodes d'une heure. Le contrat était presque rempli lors
de la première saison où l'action, à quelques minutes,
près occupait presque l'heure promise. Mais le succès appelant
la publicité, les épisodes ont été réduits
pour laisser place aux coupures commerciales pour les télévisions
américaines et ne durent plus qu'une quarantaine de minutes. L'entrée
en matière de ce quatrième volet est cependant réussie,
avec quelques moments qui valent leur pesant d'adrénaline.
VENDREDI.
Presse. La Liberté de l'Est
publie ma critique du livre de Maurice Corcos Penser la mélancolie.
Question omniprésence médiatique, Sarkozy n'a qu'à
bien se tenir.
Ferveur anonyme. Je reçois,
en provenance de la Réunion, une carte postale anonyme d'une "fervente
admiratrice même pas abonnée".
Voyage. Je parviens à m'extirper
en loucedé d'une réunion professionnelle pour attraper le
19 heures 51 en gare de Châtel-Nomexy. Dix minutes de retard annoncées,
quinze en réalité, ma correspondance à Nancy est
plus que compromise et je me vois déjà condamné à
une nuit nancéienne impromptue. Mais la SNCF a bien fait les choses
: le Strasbourg-Paris a les deux minutes de retard nécessaires
pour qui je puisse grimper dedans. Les voyages en train sont tout sauf
des voyages tranquilles.
Lecture. Mathématique du
crime (Crimenes imperceptibles, Guillermo Martinez, 2003; Nil
éditions, 2004 pour la traduction française; traduit de
l'espagnol par Eduardo Jimenez; 272 p., 19 €).
Un jeune mathématicien argentin a obtenu une bourse pour travailler
à Oxford. Peu après son arrivée, sa logeuse est retrouvée
assassinée. C'est le premier meurtre d'une série énigmatique.
L'auteur a eu l'idée d'utiliser le mot "série"
de l'expression "tueur en série" dans son sens mathématique.
Chaque meurtre est en effet accompagné d'un message comportant
un signe (un cercle, deux parenthèses accolées, un triangle...)
appartenant à une série logique : découvrir le signe
suivant, c'est découvrir le coupable. C'est un procédé
à la fois un peu lourdaud et trop faible pour servir de base à
un suspense efficace. Le livre possède tout de même des aspects
intéressants, principalement la découverte, certainement
autobiographique, du monde d'Oxford (les collèges, les concerts
de charité, la drôle de confrérie des mathématiciens)
par un parfait étranger. Pour raconter cette histoire, l'auteur
a d'ailleurs adopté un style de chaisière anglaise parfois
amusant ("Nous fîmes l'amour, en proie à une joyeuse
et irrésistible animalité"), comme s'il voulait retrouver
l'image d'une Angleterre de carte postale. Par ailleurs, Guillermo Martinez
étant mathématicien lui-même, son livre offre des
échappées tout à fait accessibles vers la philosophie
des mathématiques.
SAMEDI.
Vie parisienne. A Jussieu, je remets
le Bulletin Perec n° 47 à Bernard Magné à l'occasion
du séminaire. Mathieu Rémy est venu de Nancy parler de l'énumération
dans La Vie mode d'emploi. Il commence par différencier
l'énumération de la liste, qui est une autre des constantes
du livre, horizontalité contre verticalité, syntagme contre
paradigme, l'énumération se caractérisant avant tout
par son insertion dans une phrase verbale. Différents exemples
tirés du roman lui permettent de caractériser l'énumération
comme une image du côté prosaïque de l'existence, un
écho du système industriel (la machinerie de l'ascenseur),
un inventaire des restes d'une vie passée en compagnie des choses
(le chapitre des caves). Perec n'utilise pas l'énumération
comme un procédé facilitant l'évacuation des contraintes
mais, en émule de Rabelais et de Jules Verne, comme une ressource
poétique.
L'énumération est, avec la description, le principal obstacle
avoué par le lecteur de bonne volonté qui n'est pas parvenu
à finir La Vie mode d'emploi. Le lecteur conquis l'est,
en général, par l'inventivité et la multiplicité
des récits et/ou justement par l'aspect énumératif.
C'est cet aspect qui m'a immédiatement séduit dans le roman,
avant d'étudier et de comprendre sa construction, autre source
de jouissance qui n'est arrivée qu'à l'étape suivante.
Les énumérations sont, à mon goût, les plus
beaux passages de La Vie mode d'emploi, ceux dans lesquels Perec,
qui professait pourtant son goût pour l'écriture neutre,
blanche, laisse affleurer l'émotion. L'énumération,
ce n'est pas l'accumulation simpliste de quelques éléments
disparates pratiquée par certains écriveurs aussitôt
qualifiés par les commentateurs d'émules de Perec. L'énumération,
c'est tout sauf un jeu de remplissage, c'est la lutte contre le temps,
c'est le sable qui coule entre les doigts, c'est la tentative dérisoire
de le retenir. "Maintenant, dans le petit salon, il reste ce qui
reste quand il ne reste rien : des mouches, par exemple, ou bien des prospectus
que des étudiants ont glissés sous toutes les portes de
l'immeuble et qui vantent un nouveau dentifrice ou offrent une réduction
de vingt-cinq centimes à tout acheteur de trois paquets de lessive,
ou bien des vieux numéros du Jouet français, la revue
qu'il a reçue toute sa vie et dont l'abonnement a continué
à courir quelques mois après sa mort, ou bien de ces choses
insignifiantes qui traînent sur les parquets ou dans des coins de
placard et dont on ne sait pas comment elles sont venues là ni
pourquoi elles y sont restées : trois fleurs des champs fanées,
des tiges molles à l'extrémité desquelles s'étiolent
des filaments qu'on dirait calcinés, une bouteille vide de coca-cola,
un carton à gâteaux, ouvert, encore accompagné de
sa ficelle de faux raphia et sur lequel les mots "Aux délices
de Louis XV, Pâtissiers-Confiseurs depuis 1742" dessinent un
bel ovale entouré d'une guirlande flanquée de quatre petits
amours joufflus, ou, derrière la porte palière, une sorte
de porte-manteau en fer forgé avec un miroir fêlé
en trois portions de surfaces inégales esquissant vaguement la
forme d'un Y dans l'encadrement duquel est encore glissée une carte
postale représentant une jeune athlète manifestement japonaise
tenant à bout de bras une torche enflammée."
Bonne semaine.