Notules dominicales de culture domestique n°124 - 7 septembre 2003
DIMANCHE.
Itinéraire patriotique départemental.
Nous partons à la découverte du monument aux morts de Ban-sur-Meurthe-Clefcy,
commune difficile à trouver à cause d'un mastic sur la carte.
TV. Les grands magasins (I
Grandi Magazzini, Mario Camerini, Italie, 1939 avec Vittorio De Sica,
Assia Noris, Enrico Glori; diffusé sur France 2 en septembre 1999).
Une vendeuse est accusée d'avoir dérobé un vêtement
dans le grand magasin où elle travaille. Son mariage est menacé.
Dans l'Italie mussolinienne, les films à l'eau de rose s'appelaient
des films de "téléphones blancs", objets symboliques
du luxe intérieur dont rêvaient les jeunes filles. Ces films
sentimentaux, inspirés des comédies américaines,
étaient dépourvus de toute critique sociale et avaient pour
but d'anesthésier le bon peuple en le faisant rêver. Je ne
sais si tous les films de téléphones blancs sont de la qualité
de ces Grands magasins mais il faut convenir que ce film est d'un
niveau au-dessus de la moyenne. On y voit la star italienne du moment,
Assia Noris (épouse de Camerini), aux prises avec un amour contrarié,
accusée d'un vol, poussée au mariage par un chef libidineux
(ce qui introduit une critique de la hiérarchie inhabituelle dans
le genre) et s'en sortir dans le happy end obligatoire. Le jeune
De Sica et sa partenaire forment un couple idéal, les péripéties
sont nombreuses, il suffit d'ajouter un doigt d'humour et le tour est
joué. Exemplaire.
LUNDI.
Pré-rentrée. Journée
longuette au collège où je m'efforce d'apparaître
civil auprès des nouveaux venus. Je prends livraison des 37 Série
Noire et Série Blême dénichés par J.-C. F.
Le meilleur moment est celui où la sous-maxé, adepte du
principe de précaution, raconte au moyen d'interminables circonlocutions
préventives les affres qu'elle a traversés pour confectionner
les emplois du temps des professeurs (pour un collège qui est loin
d'être gigantesque et avec l'aide des logiciels spécialisés
tout de même). Il s'agit de désamorcer tout mécontentement.
Prophylaxie inutile : une fois le précieux document distribué,
personne n'est satisfait.
Courriel. Échange avec F.G.
au sujet de La mémoire louvrière et de La peinture
à Dora.
F. est de retour sur la toile.
Y. me conseille la lecture du Tableau du maître flamand d'Arturo
Perez Reverte.
TV. Lulu (Jean-Henri Roger,
France, 2002 avec Jean-Pierre Kalfon, Bruno Putzulu, Elli Medeiros, Gérard
Meylan; diffusé sur Canal + en août 2003).
Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Lulu, ancienne prostituée transsexuelle,
tient un bar. Son ancien Mac est assassiné, elle est accusée.
On ne croit pas plus au personnage de Lulu qu'à l'enquête
policière. Jean-Henri Roger aime son pays, on l'avait déjà
vu dans Cap Canaille, film aussi poussif, cherche à en saisir
la lumière et la magie mais manque de conviction. Seule chose notable
: Guédiguian et Ascaride tiennent un restaurant à l'Estaque,
à l'enseigne de Marius et Jeannette.
MARDI.
Promotion.
"Septembre : en septembre, l'été cesse et les élèves
rentrent" (Pierre Fustec, "Le sens réel de cent trente-sept
termes", lexique monovocalique).

Cliquer
sur l'image pour l'agrandir
Avec l'entrée
d'Alice en maternelle, nous passons du statut de parents d'élève
à celui de parents d'élèves. A l'issue de sa première
journée au cours préparatoire, Lucie est soufflée
d'avoir fait des "mathématiques".
Jardin. Nettoyage de fin de saison.
je scie un lilas victime de la sécheresse et les tiges des topinambours.
Cinéma. Les Égarés
(André Téchiné, France, 2003 avec Emmanuelle Béart,
Gaspard Ulliel, Grégoire Leprince-Ringuet, Clémence Meyer,
Samuel Labarthe, Eric Krekenmayer).
En juin 1940, sur la route de l'exode, une mère et ses deux enfants
rencontrent un adolescent qui les entraîne dans un bois voisin pour
les protéger. Ils s'installent dans une maison inoccupée.
Téchiné filme une sorte de parenthèse dans la guerre,
quelques jours dans un cadre enchanteur et mystérieux (nature et
photo magnifiques) au cours desquels une femme vit une expérience
en dehors de ses repères habituels. Après la révélation
finale, elle retrouvera la vie ordinaire de l'époque dans un camp
de réfugiés mais rien ne pourra plus être comme avant.
Tout ça à cause d'une rencontre, d'un jeune homme énigmatique,
un personnage insaisissable qui révèle un acteur étonnant,
Gaspard Ulliel. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui reste tabou dans
cette période bouleversée, c'est ce dérèglement
des normes qui intéresse Téchiné. Son film apparaît
également hors du temps et des sentiers battus, très éloigné
de celui de Rappeneau sur la même période (Bon voyage),
moins riche, moins brillant, moins captivant aussi.
MERCREDI.
Courrier. N. a repris le collier à
Stockholm.
Bibliothèque municipale. Je
glane des incipit géographiques pendant que les filles assistent
à "L'heure du conte".
Cinéma. La petite Lili
(Claude Miller, France, 2003 avec Ludivine Sagnier, Robinson Stévenin,
Bernard Giraudeau, Nicole Garcia, Jean-Pierre Marielle, Julie Depardieu,
Yves Jacques, Anne Le Ny, Marc Betton).
Mado, actrice célèbre, passe ses vacances en Bretagne en
compagnie de son frère, de son fils Julien qui veut devenir cinéaste,
de son amant Brice, réalisateur à succès et d'autres
encore.
La petite Lili est paraît-il une libre adaptation de La Mouette.
Je ne connais pas la pièce de Tchekhov et le film, dans sa première
partie du moins, m'a plutôt rappelé Le Genou de Claire
d'Éric Rohmer : le cadre, une propriété au bord de
l'eau, et les jeux amoureux entre un homme mûr (Giraudeau à
la place de Jean-Claude Brialy) et une adolescente (Sagnier). L'épilogue
voit Julien réaliser le film dont il rêvait et mettre en
scène l'histoire à laquelle on a assisté au début.
Cette conclusion en forme de film dans le film rappelle, en mieux, Qu'est-ce
qui fait courir David ? d'Élie Chouraqui. Alors où se
cache Tchekhov ? Dans les relations entre les personnages, probablement,
représentatifs de plusieurs générations, et dans
les dialogues. Julien, qui rêve de cinéma, s'oppose à
Brice qui en fait et à sa mère qui en vit. Il ne conçoit
l'art qu'en opposition aux autres, que comme une réaction contre
ce qui existe, vision intéressante qui était peut-être
celle de Tchekhov. Ce que Claude Miller évite soigneusement de
dire, c'est s'il se range du côté de Julien l'insoumis ou
de Brice l'assagi dans son travail de cinéaste.
Curiosité 1. On note la présence de Marc Betton, le commissaire
Meurtaux de la série P.J., qui attirera certainement moins de spectatrices
que Bruno Wolkowitch.
Curiosité 2. Le film dont on voit le tournage à la fin s'intitule
La Disparition. Rien à voir avec Perec.
Curiosité 3. Michel Piccoli joue, dans ce film bis, le rôle
de Jean-Pierre Marielle. On le voit dans deux scènes, c'est tout.
Piccoli semble se faire une spécialité de ces brèves
apparitions. On le voyait déjà entre deux portes dans Un
homme, un vrai des frères Larrieu.
Curiosité 4. Après Lulu, vu lundi, et cette Lili,
il me reste à voir Les Lolos de Lola de Jean-Pierre Dubois,
Lily aime-moi de Maurice Dugowson, Leila, la bête érotique
(!) de William Rostler, les films de René Laloux, Claude Lelouch,
ceux de Gina Lollobrigida et de Folco Lulli et ceux mis en musique par
Lalo Schifrin pour mener à bien cet épuisement allitératif.
VENDREDI.
Courrier. Carte postale de N.H., de
Carcassonne.
J'envoie une revue de presse à Y. et la notification de mon désengagement
syndical à la CFDT.
SAMEDI.
T.V. Jules César (Julius
Caesar, Joseph L. Mankiewicz, USA, 1953 avec Marlon Brando, Greer
Garson, James Mason; diffusé sur CinéClassics en ?).
Le complot de Cassius et Brutus contre Jules César.
Ce n'est pas ici le même Mankiewicz que celui qui devait ruiner
la Fox dix ans plus tard avec son Cléopâtre démesuré.
Ce qui intéresse Mankiewicz dans Jules César, ce
n'est pas la reconstitution historique (quelques colonnes et une statue
de Pompée suffisent à meubler toute la première moitié
du film) ni les scènes de foule (la bataille de Philippes est vite
éludée), c'est le texte, à savoir la pièce
de Shakespeare. Le réalisateur se fait metteur en scène
de théâtre, n'hésite pas à faire jouer ses
acteurs de façon très expressive (les Anglais, James Mason,
John Gielgud, Deborah Kerr qui pratiquent Shakespeare depuis la maternelle,
comme Marlon Brando, plus inattendu), à filmer des monologues.
Il fallait, pour apprécier ce film, être en meilleure forme
que je ne l'étais. Ma réapparition sur la scène publique
après deux mois de terrier qui correspondent davantage à
ma nature profonde, les neuf heures d'émissions sur Baudelaire
enregistrés sur France Culture de 2 heures 30 à
4 heures du matin toutes les nuits de la semaine, les invités
d'hier soir qui sont partis à point d'heure et la détresse
d'Alice pour se premiers jours à l'école ont quelque peu
mité mon tissu de sommeil ces derniers temps.
Curiosité. La scène est connue mais ça reste un vrai
plaisir de voir Brutus, avant le coucher, prendre un livre relié
et même chercher la page qu'il y a cornée. Mais il paraît
que ce détail anachronique était déjà dans
Shakespeare.
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°125 - 14 septembre 2003
DIMANCHE.
Fin de saison. Nous faisons nos adieux
à Saint-Jean-du-Marché. Je pense aux Nabokov qui regagnaient
Pétersbourg après l'été passé à
Vyra, sur les rives de l'Orédej.
Itinéraire patriotique départemental.
Découverte du monument aux morts de Barbey-Seroux et, au passage,
d'un bar clos sur le plateau de Champdray. En chemin me vient l'idée
d'une nouvelle série photographique, celle des publicités
peintes sur les maisons. Ou plutôt de ce qu'il en reste car elles
sont vraiment en voie de disparition. "Je me souviens des publicités
peintes sur les maisons" (Georges Perec, Je me souviens, Jms
n° 365).
Famille. Naissance d'une nièce
à Montbéliard, Julie.
Notules. Une demande de désabonnement.
Elle émane d'un professeur qui s'était dit alléché
par le récit de mes inspections. La remise aux normes de ma vie
professionnelle a dû le décevoir.
TV. Swing (Tony Gatlif, France,
2002 avec Oscar Copp, Lou Rech, Tchavolo Schmitt, Mandino Reinhardt; diffusé
sur Canal + en août 2003).
Max, dix ans, veut apprendre à jouer de la guitare. Il se rend
dans le quartier des gitans où il est peu à peu accepté.
Le mérite de Tony Gatlif est de réaliser un film musical
dans lequel la musique n'est pas le seul élément, le seul
prétexte. On ne peut pas dire qu'elle passe inaperçue, elle
est omniprésente mais elle est intégrée au film comme
à la vie des manouches. Inutile de dire qu'elle est de qualité,
avec Tchavolo Schmitt pour la servir, qui n'hésite pas à
mêler le style purement manouche aux mélodies arabisantes
ou aux orchestrations klezmer.
Il y a donc autre chose dans Swing que la musique. Il y a Swing
d'abord, un personnage adolescent androgyne pour qui Max va se prendre
d'amitié puis d'amour. Il y a aussi, et c'est à ça
que tient Gatlif, la communauté, ses richesses, ses travers (le
brocanteur interprété par Mandino Reinhardt), son passé
qu'il aime décliner de film en film. Le résultat est assez
plaisant.
LUNDI.
Santé. Diagnostic d'un légère
myopie de l'œil droit chez Lucie.
Courriel. P.A. me donne tous les éléments
qui relient La petite Lili de Claude Miller à La Mouette
de Tchekhov. Au moment où il dit apprécier la régularité
avec laquelle les notules lui parviennent, deux abonnés se plaignent
de ne pas avoir reçu le dernier numéro.
MARDI.
TV. Safe (Todd Haynes, USA,
1995 avec Julianne Moore, Xander Berkeley, Peter Friedman, James Le Gros,
Dean Norris; diffusé sur Arte en juin 1999).
Todd Haynes fait de Julianne Moore, comme il le fera plus tard dans Loin
du Paradis, une femme parfaitement intégrée à
son milieu, à son époque. On n'est pas ici dans les années
50 mais en 1987. Carol, épouse rangée, s'occupe principalement
de son intérieur cossu et de son apparence physique. Les séances
d'aérobic alternent avec les visites des décorateurs, les
conseils des amies permettent d'essayer de nouveaux régimes. Une
vie sur papier glacé qui se déchire non pas à cause
d'une rencontre ou d'une révélation comme dans Loin du
Paradis mais à cause de son corps : crises d'asthme, allergies
qui semblent provoquées par la pollution et qui entraînent
des angoisses incontrôlables. Après avoir essayé la
médecine traditionnelle et la psychiatrie, Carol trouve refuge
dans une sorte de communauté écologique. Le cocon s'avère
aussi effrayant que le monde extérieur : là-bas, les fumées
d'échappement, les usines chimiques, les aérosols, ici une
gentillesse new age, des gourous douteux, un bien-être artificiel.
Tout l'habileté de Todd Haynes consiste à montrer qu'il
n'y a pas d'issue pour son personnage, pris au piège d'une société
qui engendre des monstres, puis d'autres monstres pour combattre les premiers.
Safe est un film très dérangeant par son sujet et par son
traitement. Le vide des espaces, l'environnement sonore (les bruits des
climatiseurs, des moteurs...) distillent une vraie sensation de malaise.
C'est aussi un film inhabituel dans la mesure où il montre quelque
chose que le cinéma n'aime guère, à savoir la maladie
(exemples récents : Haut les cœurs d'Anspach, le dernier
Chéreau paraît-il), beaucoup moins esthétique que
la mort.
MERCREDI.
Emplettes. J'achète deux volumes
de Jules Verne, récupère ma montre Proust chez un bijoutier
plus compétent que celui de Romorantin.
Courrier. Une carte postale de H.,
de passage dans le Vercors avant une nouvelle opération à
Marseille.
TV. Football. Slovénie - France
(0-2).
JEUDI.
Courrier. J'envoie une revue de presse
à Y. et à l'AGP.
Téléphone. Je reçois
un appel contrit du directeur de la chaîne McDonald's pour la région
Centre suite à un différend qui m'avait opposé à
une de ses employées à Romorantin, au dernier soir de nos
vacances. Il m'invite, avec ma famille, à revenir me restaurer
à ses frais dans un de ses établissements quand je veux.
La perspective d'une expédition Épinal - Romorantin, dix
bonnes heures de route, pour aller croûter gratuitement dans un
McDo' est assez alléchante mais sera difficile à faire accepter
à mon entourage.
Cinéma. Père et Fils
(Michel Boujenah, France, 2003 avec Philippe Noiret, Charles Berling,
Bruno Putzulu, Pascal Elbé, Jacques Boudet, Céline Thiou,
Eva Saint-Paul, Mathieu Boujenah).
Après une légère alerte cardiaque, Léo simule
une maladie grave et organise un voyage au Québec pour réconcilier
ses trois fils.
Un film gentil certes, pour célébrer le sens de la famille,
mais surtout un film lourdingue. En laissant la bride sur le cou à
Philippe Noiret dans un rôle qui appelle le cabotinage, Michel Boujenah,
qui comme acteur n'est pas un spécialiste de la dentelle, s'est
fait avoir dans les grandes largeurs. Laisser un centimètre carré
de couette à Noiret, c'est s'exposer à dormir à la
belle étoile. De fait, Berling et Putzulu apparaissent bien pâles,
le seul à tirer son épingle du jeu étant Pascal Elbé,
un nouveau venu qui ne m'a peut-être plu que parce qu'il ressemble
à Laurent Jalabert. Il y a bien des gags, des situations amusantes
qui marchent d'autant mieux qu'on a le temps de les voir venir. Ça
fonctionne quand trois personnages font front contre le quatrième,
mais pas quand il y a des oppositions d'homme à homme (voir la
rivalité ridicule entre Berling et Putzulu).
On se demande quel besoin il y avait d'embarquer tout ce joli monde pour
un tournage sûrement coûteux au Québec alors qu'on
nous présente des paysages du Haut-Doubs (qui vaut bien le Québec
pour l'accent). Il y a quand même un aspect original, le fait que
la légendaire (et réelle, je ne voudrais pas froisser les
notuliens de la Belle Province) hospitalité québécoise
est légèrement mise à mal. Au cours de leur périple,
les quatre voyageurs ne rencontrent qu'un automobiliste escroc, un chauffard
irascible, un costaud jaloux et violent, un flic mal embouché et
une naturopathe alcoolique. Je suis sûr qu'on aurait pu trouver
les mêmes dans le Haut-Doubs.
VENDREDI.
Notules. Une demande d'abonnement
vient compenser la défection de dimanche dernier.
Nouvelles technologies. Longue bataille
nocturne pour créer une boîte à lettres personnelle
à Caroline sur Outlook.
SAMEDI.
Courrier. Une lettre de la direction
nationale de McDonald's avec des invitations à utiliser dans n'importe
quel établissement. Et mon week-end à Romorantin ?
On a dû diffuser mon signalement dans toutes les succursales de
la chaîne avec la mention "Emmerdeur n° 1". Me voici
devenu le La Reynière des trucs mous.
Prothèse. Lucie change de look.
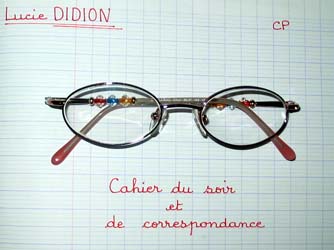
Cliquer
sur l'image pour l'agrandir
Football.
SAS - Illhaeusern 4-0.
TV. Vidange (Jean-Pierre Mocky,
France, 1998 avec Marianne Basler, Jean-Pierre Mocky, Laurent Labasse;
diffusé sur Canal + en octobre 1999).
Fraîchement mutée à Paris, la juge Mireille Bertillet
sème la panique en multipliant les mises en examen dans les milieux
politiques et affairistes.
La réactivité de Mocky sur les sujets chauds est une de
ses caractéristiques. A peine commence-t-on, à la suite
d'un certain nombre d'affaires impliquant des hommes politiques, à
parler de "république des juges" qu'il en fait un film.
A sa manière bien sûr, en y exposant ses idées un
rien poujadistes et ses "trognes" (Attal et Zardi, Jacques Legras,
Roger Knobelspiess, Jean Abeillé qui connut son heure de gloire
comme speaker d'Arte) maquillées et filmées en gros plan.
Le combat de sa juge pour une opération mains propres donne un
Mocky plutôt au-dessus de la moyenne, avec une Marianne Basler qui
est la seule à jouer juste et sans outrance.
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°126 - 21 septembre 2003
DIMANCHE.
Itinéraire patriotique départemental.
Excursion près de Neufchâteau pour découvrir le monument
aux morts de Barville. Les filles inaugurent leurs nouveaux bicycles sur
une petite route en bordure de forêt. Route calme, très calme,
trop calme, nous en trouverons l'explication au détour d'un virage.

Courriel.
J.-M.P. m'envoie de la documentation sur les publicités murales
en Belgique.
LUNDI.
Courrier. Je reçois la troisième
partie du Boudin sacré, par les protagonistes de Signé
Furax.
TV. La Cage (Alain Raoust,
France, 2002 avec Caroline Ducey, Roger Souza, Philippe Cariou, Maryvonne
Schiltz; diffusé sur Canal + en septembre 2003).
Anne a passé sept ans en prison pour homicide. Libérée,
elle décide de partir rencontrer le père de sa victime.
D'ordinaire, c'est l'inverse : le père de la victime attend que
le meurtrier sorte de prison pour lui régler son compte (voir Crossing
Guard de Sean Penn). L'aboutissement est le même dans les deux
sens, une confrontation qui peut aboutir au pardon, au refus du pardon,
à un nouveau meurtre. On peut traiter ça de façon
spectaculaire, avec du suspense et des effets. Rien de cela chez Raoust
qui refuse tout artifice pour se consacrer uniquement à son héroïne,
pour la suivre pas à pas, enregistrer ses paroles ou plus exactement
ses silences. Démarche sans concession à laquelle on peut
adhérer si on est en bonne forme physique.
MARDI.
T.V. Football. Real Madrid - Olympique
de Marseille (4-2).
MERCREDI.
Presse. J'achète Femme actuelle
où apparaît Y., en apothéose de son été
médiatique. D'habitude, je suis plutôt Voici où
j'aime à lire de temps en temps la chronique littéraire
de Frédéric Beigbeder.
Réflexions sur la question notulienne.
A la bibliothèque municipale, je rencontre DDL, notulien. Une rencontre
peu surprenante puisque DDL, notulien, travaille à la bibliothèque
municipale. D'un naturel plutôt casanier, je rencontre peu de notuliens.
Pourtant, à l'heure où le pape met ce qui lui reste de santé
en jeu pour aller saluer les catholiques slovaques, à l'heure où
Jacques Chirac reprend contact avec la population française au
cours d'un voyage dans l'Yonne, il faut que le notulographe aille à
la rencontre des notuliens d'en bas. Il faut que le notulographe descende
de sa notulomobile pour serrer des mains de notuliens, embrasser des joues
de notuliennes, flatter la croupe des vaches des notulmen-farmers, porter
à bout de bras des enfants de notuliens, ou des petits-enfants
de notuliens âgés, ou des neveux, nièces, filleuls,
que sais-je, de notuliens sans descendance directe. La notulie de proximité
est à ce prix.
Lecture. L'insoutenable légèreté
des contraintes, numéro spécial hors commerce de la
revue FORMULES, réalisé dans le cadre de l'opération
"Littérature en Jeu", produite pas les bibliothèques
de Beauvais, Amiens et Issy-les-Moulineaux, avec l'aide de la DRAC de
Picardie (Noésis 2002, 62 p.).
Défense et illustration de la contrainte au moyen de textes courts
dus à des habitués de la [listeoulipo] qui jouent sur les
phrases, les mots, les syllabes et surtout les lettres. Pas d'obscurantisme
ici : l'éditorial explique clairement la contrainte qui régit
chacun des textes ou presque (le titre du texte de Michel Clavel, notulien,
suffit à en comprendre le principe). Certaines contraintes sont
connues (ce qui ne veut pas dire faciles) : lipogrammes, palindromes,
acrostiches, monovocalismes... D'autres sont nouvelles, dont les "montagnes
russes" de Patrick Flandrin, sonnets dans lesquels "chaque mot
ne diffère du mot précédent et du mot suivant que
par une lettre de plus ou de moins". Il est difficile de mettre en
avant tel ou tel auteur - d'autant plus qu'il y a des notuliens dans le
lot - mais il est aussi difficile de ne pas souligner la virtuosité
de Gilles Esposito-Farèse dans plusieurs domaines.
Curiosité 1. "Papa se jeta aux pieds de maman en lui répétant
pardon, pardon. Elle l'absolut de bonne grâce" (Michel Clavel).
Bescherelle dit que le passé simple du verbe absoudre n'existe
pas, Larousse le dit inusité, mais Robert et Grevisse mentionnent
bien la forme "absolut".
Curiosité 2. "Pied normal
Mord Épinal", deux des soixante vers anagrammatiques sur le
mot palindrome dus à Alain Zalmanski.
Cinéma. Les Associés
(Matchstick Men, Ridley Scott, USA, 2003 avec Nicolas Cage, Sam Rockwell,
Alison Lohman, Bruce Altman, Steve Eastin, Beth Grant, Bruce McGill, Daniel
Villareal, Menora Walters).
Roy Waller est un personnage chargé, voire surchargé. Surchargé
d'argent (celui qu'il empoche grâce aux petites arnaques montées
avec son associé Frank Mercer), surchargé de tics et de
phobies (il est agoraphobe, maniaque de la propreté au point de
renoncer à se brûler la cervelle pour ne pas tacher sa moquette)
et qui se découvre un beau jour chargé de famille. Angela,
quatorze ans, l'enfant qu'attendait sa femme lorsqu'il l'a quittée,
débarque dans sa vie et bien sûr la bouleverse. Nicolas Cage,
impeccable, supporte tout ce poids avec élégance, son comparse
Sam Rockwell est aussi virevoltant que dans Box of Moonlight et,
pendant une heure, on jubile devant cette comédie séduisante
et soignée.
Ensuite, Ridley Scott donne une orientation différente à
son film. Une arnaque tourne mal et les ennuis s'accumulent sur la tête
de Roy Waller. Cette deuxième partie est tout aussi réussie,
le savoir-faire du réalisateur et des acteurs fait merveille. Le
dénouement, teinté d'amertume et de sérénité
retrouvée, boucle le tout sans distiller une once de déception
ou d'agacement et montre que le talent de Ridley Scott est réel
et peut se passer des grosses machineries genre Gladiator ou La
Chute du Faucon noir.
JEUDI.
Courriel. Y. est en conflit avec le
chargé de communication de l'association "Lévriers
en détresse". Ce qui peut amener à s'étonner,
au choix, de l'existence des lévriers, de celle de lévriers
en détresse, de celle d'une association chargée de les défendre
ou de celle d'un chargé de communication attaché à
cette association.
ARB me signale la sortie de L'Almanach de Georgette, un livre de
Claude Daubercies à qui je dois d'avoir découvert André
Frédérique.
BV me convie à célébrer le poète Florent Gilbert
à Fontenoy-le-Château.
Lecture. Lire la peinture. Dans
l'intimité des oeuvres (Nadeije Laneyrie-Dagen, Larousse, coll.
Reconnaître/Comprendre 2002, 276 p., 27 ).
Ce livre répond tout à fait au besoin que j'avais de trouver
rassemblés en un lieu unique les parcelles de connaissance sur
la peinture acquises en des endroits dispersés (radio, télévision,
catalogues d'expositions, ouvrages théoriques, expériences
de visu). On y part du tableau en tant qu'objet (support, matériaux)
avant de parler de son sujet (les genres) et de sa composition. C'est
cette dernière partie dont j'attendais le plus. L'auteur y donne
une bonne étude de la perspective mais passe trop rapidement sur
le nombre d'or, qu'il me faudra étudier ailleurs.
La dernière partie est en quelque sorte un aveu d'impuissance.
En essayant de faire une présentation chronologique des différents
styles, du gothique au non figuratif, Nadeije Laneyrie-Dagen ne parvient
qu'à montrer combien il est difficile de cloisonner les choses,
tant les styles se mélangent et s'interpénètrent.
Elle reconnaît d'ailleurs honnêtement le côté
un peu artificiel de son découpage qui permet tout de même
de se constituer des points de repère.
VENDREDI.
Photo. Je prends mes premiers clichés
de publicités murales.
Courier. J'envoie une revue de presse
à Y. et à l'AGP, une photo souvenir au propriétaire
de la maison de Mur-de-Sologne.
Vie familiale. Soirée moules
frites en quatuor dans une cantine de banlieue.
SAMEDI.
Visite. Ma sœur vient nous présenter
sa dernière née.
Bon dimanche.
Notules dominicales de culture domestique n°127 - 28 septembre 2003
DIMANCHE.
Bougies. Lucie a six ans. Pour l'occasion,
j'aimerais lui offrir une vue imprenable sur le monument aux morts des
Bas-Rupts, mais il n'y a pas de monument aux morts aux Bas-Rupts, qui
ne sont en fait qu'un écart de la commune de Gérardmer (mais
qui apparaissent dans la liste alphabétique du calendrier des Postes
qui me sert de feuille de route). On se rattrape en trouvant un beau coin
pour pédaler au départ des pistes de ski de fond, un bistrot
pour boire un coup dans Gérardmer envahie comme aux plus beaux
jours, et, sur la route du retour, un bar clos et une publicité
murale qui constitue pour l'instant le fleuron de ma jeune collection.

Courriel.
A propos du numéro hors commerce de Formules chroniqué dans
les notules 126, A.Z. m'indique que "si certains notuliens souhaitaient
un exemplaire, j'en ai encore quelques uns. Il peuvent également
aller piocher http://www.formules.net/revue/HS/index.htm.
Tous les textes sont libres de droits."
Echange avec GN pour savoir si la phobie de la poussière, dont
il était question dans une chronique cinématographique du
même numéro, est la misophobie, la mysophobie ou la myxophobie.
TV. Oeil pour oeil (André
Cayatte, France, 1957 avec Curd Jürgens, Folco Lulli, Lea Padovani,
Pascale Audret; diffusé sur Canal + en ?).
Le docteur Walter est dérangé à son domicile par
un homme qui lui demande de soigner sa femme. Il envoie le couple à
l'hôpital. La femme meurt. L'homme veut se venger du docteur.
Cette vengeance aura pour cadre le désert (l'histoire se déroule
entre le Liban et la Syrie) où les deux hommes s'affrontent tout
en essayant de survivre. Cette histoire vaut surtout par le personnage
de Folco Lulli, fou (de chagrin), inquiétant, insaisissable, insensible
à la chaleur et à la soif (costume cravate en grosse valise
en plein désert). Que ce soit dans une maison arabe ou dans le
désert, il est dans son élément, accepté,
alors que le médecin ne semble jamais à sa place, toujours
en conflit avec les éléments ou les êtres. Cette réunion
d'acteurs allemand et italien sous la houlette d'un réalisateur
français dans un cadre oriental selon une thématique de
western aurait pu tourner plus mal.
LUNDI.
Courriel. S.B. signale des perturbations
dans les livraisons des notules. Après recoupement, il apparaît
que les abonnés qui connaissent ces problèmes sont tous
servis par aol.fr.
T. me parle de Pierre Michon.
T.V. Ma caméra et moi
(Christophe Loizillon, France, 2002 avec Zinedine Soualem, Julie Gayet,
Julien Collet; diffusé sur Canal + en septembre 2003).
Max a toujours une caméra à la main depuis que son oncle
lui a offert son premier appareil pour son sixième anniversaire.
Il a monté une petite entreprise de vidéaste pour noces
et banquets. La rencontre d'une kinésithérapeute aveugle
va changer sa vie.
On voit souvent chez les jeunes réalisateurs ce rappel de leur
découverte du cinéma, ces images tremblotantes en Super
8 censées montrer leurs premiers pas dans la discipline. Max, porte-parole
de Loizillon, nous fait ainsi découvrir ses films de famille, mais
pour Max la caméra n'est pas un jouet. Il filme tout, du matin
au soir, vole, aime, vit pour filmer. Le côté amusant de
son livre de souvenirs - ses séances d'autopromotion sont particulièrement
drôles - est contrebalancé par la sincérité
de sa passion. Mine de rien, filmer devient par moments une question de
vie ou de mort. Servi par la bonne bouille de Zinedine Soualem, Christophe
Loizillon n'est pas toujours à la hauteur de son sujet mais son
film est porteur de promesses.
MARDI.
TV. Bureau des disparus (Bureau
of Missing Persons, Roy Del Ruth, USA, 1933 avec Pat O'Brien, Glenda
Farrell, Lewis Stone, Bette Davis; diffusé sur TCM en septembre
2003).
Le détective Butch Saunders est affecté au Bureau des Personnes
Disparues d'un commissariat de New York.
Il y a une volonté documentaire chez Roy Del Ruth dans la présentation
de ce service spécial des forces de police. Un service qui ne ressemble
pas aux autres : Saunders devra bien vite renoncer aux méthodes
abruptes qu'il affectionnait à la Brigade des Vols. Ici, aux Personnes
Disparues, on mise avant tout sur l'humanité, la compassion, la
compréhension. Dans le bureau du chef, figure paternelle et moralisatrice,
défilent époux ou épouses abandonnés, parents
venus déclarer un enfant fugueur ou reconnaître un corps
photographié à la morgue. Le chef raccommode, sermonne,
console et la vie reprend son cours. Saunders arrive là-dedans
comme un chien dans un jeu de quilles mais saura faire ses preuves et
gagner ses galons ainsi que le cœur de la belle interprétée
par Bette Davis. Dans le rôle, Pat O'Brien, venu du muet et dont
la carrière s'achèvera en 1981 dans le Ragtime de
Milos Forman, est assez pénible, principalement dans sa manière
d'aboyer toutes ses répliques.
Lecture. W ou le souvenir d'enfance
(Georges Perec, Denoël, 1975; rééd. Gallimard,
coll. L'Imaginaire n° 293, 224 p., 42 F).
Relecture.
Au départ, je souhaitais simplement marquer sur mon exemplaire
les sutures (retours d'énoncés identiques ou similaires
dans les parties fiction et autobiographie qui se succèdent en
alternance dans le texte) relevées par Bernard Magné dans
les Cahiers Georges Perec n°2 et préparer la lecture des textes
de Philippe Lejeune sur le Perec autobiographe. Mais comme d'habitude,
la relecture de Perec m'a entraîné un peu plus loin que le
stade atteint lors de la lecture précédente (juin 1999 en
l'occurrence). D'abord, elle m'a permis de redécouvrir la première
partie de fiction, celle consacrée au naufrage du Sylvandre, que
ma mémoire refuse à chaque fois de fixer. Ensuite, elle
m'a fait trouver de nouveaux échos, de nouveaux éléments
dissimulés, vu que, depuis la dernière fois, j'ai découvert
Thomas Mann et approfondi ma connaissance de Kafka. Ainsi, ce qui m'apparaissait
comme le passage le plus poignant de la partie autobiographie ("Moi,
j'aurais aimé aider ma mère à débarrasser
la table de la cuisine après le dîner. Sur la table, il y
aurait eu une toile cirée à petits carreaux bleus; au-dessus
de la table, il y aurait eu une suspension avec un abat-jour presque en
forme d'assiette, en porcelaine blanche ou en tôle émaillée,
et un système de poulies avec un contrepoids en forme de poire.
Puis je serais allé chercher mon cartable, j'aurais sorti mon livre,
mes cahiers et mon plumier de bois, je les aurais posés sur la
table et j'aurais fait mes devoirs. C'est comme ça que ça
se passait dans mes livres de classe.") est en fait un démarquage
de L'Amérique de Kafka ("N'était-ce pas ainsi que Karl
- Dieu, qu'il y avait donc longtemps ! - restait assis à la maison
à la table de ses parents pour faire ses devoirs tandis que son
père lisait le journal ou mettait à jour les comptes ou
la correspondance d'une société et que la mère, occupée
de quelque couture, levait l'aiguille en tirant le fil. Pour ne pas déranger
son père, Karl ne posait que son cahier et son encrier sur la table,
laissant à droite et à gauche sur des chaises les livres
dont il avait besoin.")
Curiosité. "Deux jours plus tard, ma tante m'a envoyé
chercher du pain en bas de la rue. En sortant de la boulangerie, je me
suis trompé de direction et au lieu de remonter la rue de l'Assomption,
j'ai pris la rue de Boulainvillers : j'ai mis plus d'une heure à
retrouver ma maison." C'est un des derniers souvenirs rapportés
par Perec, qui a alors 8 ans. Il m'a permis de retrouver un souvenir parisien
personnel presque identique que je pourrais raconter en ces termes : "Un
jour, j'avais environ 8 ans, ma grand-mère m'a envoyé chercher
des langues de chat en bas de la rue. En sortant de l'épicerie,
je me suis trompé de direction et au lieu de reprendre la rue Maurice-Bouchor,
j'ai pris la rue ? et je me suis retrouvé peut-être sur le
boulevard Brune. Il faisait nuit quand j'ai retrouvé ma maison."
MERCREDI.
Emplettes. J'achète un
volume sur les fous littéraires et un beau livre sur l'Annonciation
italienne.
Cinéma. Good Bye Lenin !
(Wolfgang Becker, Allemagne, 2003 avec Daniel Brühl, Katrin Sass,
Maria Simon, Chulpan Khamatova, Florian Lukas, Alexander Beyer, Burghart
Klaussner, Christine Schon, Michael Gurisdek).
A la veille de la chute du mur de Berlin, une femme est terrassée
par un infarctus et sombre dans le coma. A son réveil, les médecins
avertissent ses enfants que le moindre choc émotionnel peut lui
être fatal. Comment cacher les transformations de la société
allemande réunifiée à cette communiste convaincue
?
Les bouleversements qu'a connus l'Allemagne au cours des quinze dernières
années constituent une vraie mine à scénarios, curieusement
sous-exploitée. Wolfgang Becker a choisi de montrer les mille et
une ruses inventées par un jeune homme pour cacher à sa
mère la disparition de son pays et de son idéal. Ces ruses
(recherche de meubles, de vêtements, de produits alimentaires de
l'époque "d'avant", réalisation de faux bulletins
d'informations télévisées) sont prétextes
à autant de saynètes mises bout à bout sans véritable
fil conducteur. On aboutit à un collage de vignettes inégales
dans la drôlerie, dans lesquelles s'agite le jeune homme et qui
finit par lasser. Le dénouement interminable qui, sur le registre
mélodramatique, montre les retrouvailles de la mère avec
son mari passé à l'Ouest, enfonce davantage le film, peu
aidé de surcroît par une interprétation médiocre
et par les arpèges dégoulinants de Yann Tiersen qui semble
recycler les chutes d'Amélie Poulain. On se rappelle alors un autre
film dans lequel une famille s'employait à reconstituer le passé
pour masquer le présent à un grand malade. C'était
Hibernatus, d'Édouard Molinaro, c'était Louis de
Funès et c'était plus drôle.
JEUDI.
Courrier. J'envoie des coupures à
Y., à l'AGP, aux C. et aux M., commande une montre aux Musées
de France.
Cinéma. Les Invasions barbares
(Denys Arcand, Canada, 2003 avec Stéphane Rousseau, Marie-Josée
Croze, Marina Hands, Remy Girard, Dorothée Berryman, Johanne Marie
Tremblay, Louise Portal).
Sébastien, golden boy à Londres, est appelé au chevet
de son père, Rémy, gravement malade. Il rentre à
Montréal et organise la réunion des amis de Rémy
pour adoucir son agonie.
D'abord, un regret personnel, celui de ne pas avoir vu Le Déclin
de l'empire américain qui, il y a quinze ans, rassemblait déjà
les mêmes personnages devant la caméra de Denys Arcand. Pas
parce que cette méconnaissance nuit à la compréhension
de cette suite qui constitue un tout parfaitement autonome, mais parce
que si le premier volet est au niveau de celui-ci, j'ai vraiment raté
quelque chose. Les Invasions barbares est un film brillant qui
fait le bilan d'une société, d'une génération
rassemblée au chevet d'un mourant. Rémy, professeur d'université,
est un jouisseur qui a profité au maximum des plaisirs d'une existence
qu'il se refuse à quitter sans révolte. Ces discussions
qu'il mène avec ses amis, son fils, son ex-femme, les infirmières,
une religieuse, les médecins, abordent aussi bien la vie de sainte
Maria Goretti que Françoise Hardy, Primo Levi, la mort de Félix
Faure, l'amour, la religion, la mort bien sûr, la politique de santé
au Québec, la mise en perspective historique des attentats du 11
septembre 2001, Jean-Luc Godard ou la révolution culturelle chinoise
(un moment hilarant). Les dialogues ciselés sont un véritable
régal mais même si le film est avant tout oral, voire dialectique,
Arcand a su mettre ses dialogues en scène. Le long travelling avant
d'ouverture qui nous fait traverser les couloirs d'un hôpital de
Montréal aussi encombrés que les travées du souk
d'Istanbul, la façon de filmer des personnes qui passent leur temps
à jaser dans une chambre d'hôpital sans ennuyer ni se cogner
aux murs, la peinture d'une nature discrète et somptueuse sont
autant de réussites.
Reste le sens, le propos du film. Le sous-titre en est "Le déclin
continue", ce qui oriente vers un constat d'échec pour la
génération de Rémy. Mais si les propos sont souvent
amers, les personnages ne sont pas abattus, les échecs professionnels,
politiques ou sentimentaux n'ont pas entamé ce qu'ils possèdent
en commun et maîtrisent : une certaine dose de culture qui permet
de relativiser la réalité et surtout la maîtrise et
le goût du langage, du mot, auquel Arcand fait un triomphe et qui
sort grand vainqueur du film.
VENDREDI.
TV. 24 heures chrono (saison
2, épisodes 1 & 2, diffusés sur Canal + le 20 septembre
2003).
Changement d'échelle : ce n'est pas un homme qui est menacé
mais, cette fois, une ville entière, Los Angeles, où doit
exploser une bombe nucléaire, pas moins. Même principe :
Jack Bauer, qu'on découvre veuf, déprimé et inactif
au début de l'histoire, a 24 heures, illustrées en autant
d'épisodes, pour déjouer l'attentat. Même procédé
: des foyers de crise fixes (la cellule anti-terroriste, le Q.G. de la
Présidence, le repaire des terroristes) et des éléments
mobiles qui vont de l'un à l'autre (Jack Bauer d'un côté
et, de l'autre, sa fille qui a le chic pour se mettre dans des situations
impossibles). La mise en place est rapide et prometteuse.
SAMEDI.
Courriel. Une demande d'abonnement
(en vers !) pour les notules.
TV. 24 heures chrono (saison
2, épisodes 3 & 4, diffusés sur Canal + le soir-même).
Il y en a là-dedans qui ont l'air trop méchants et d'autres
qui ont l'air trop gentils. On se rappelle la première saison où
on s'est fait trimballer par la jolie Nina pendant 23 épisodes
: on se méfie...
Bon dimanche.